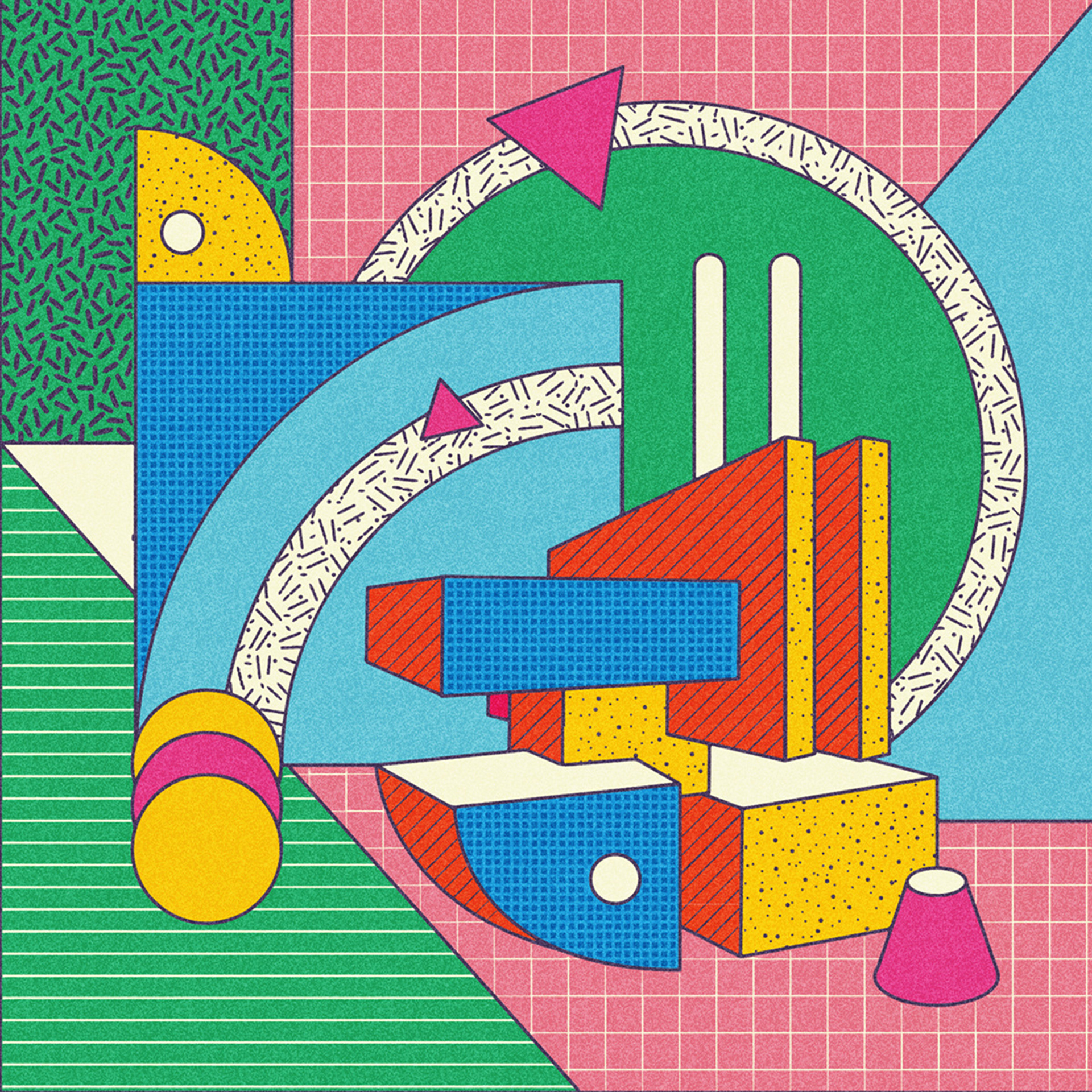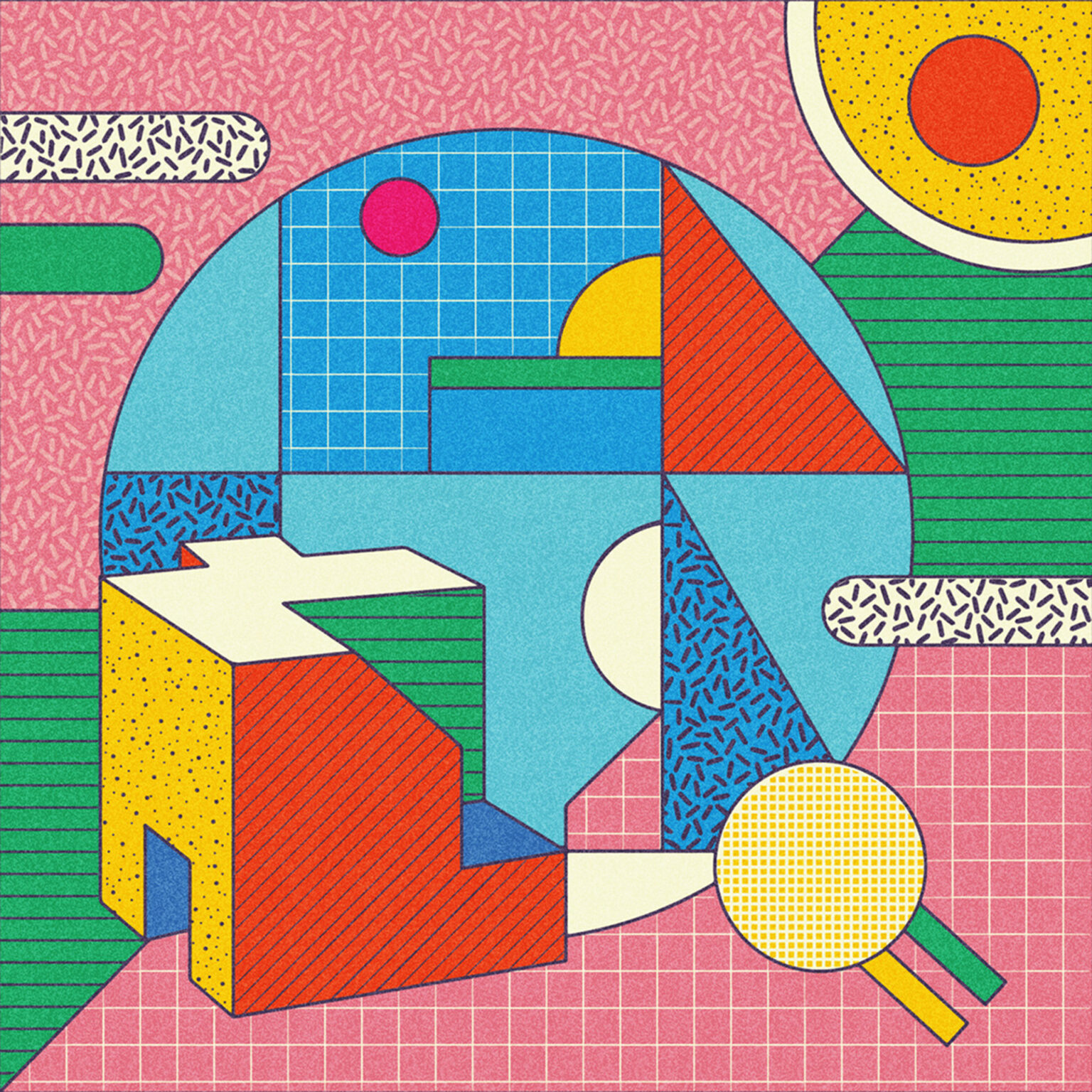21 Avr Te plains pas, c’est pas l’usine : L’exploitation en milieu associatif (Extrait)
Par STELLA FIHN et LILY ZALZETT
Publié le 21 avril 2020
Si la gauche considère depuis longtemps l’usine comme le lieu ultime de l’exploitation de ses ouvriè·re·s, dans le livre Te plains pas, c’est pas l’usine: l’exploitation en milieu associatif, Lily Zalzett et Stella Fihn proposent de tourner leur regard vers les milieux associatifs en France. Un peu comme dans les organismes communautaires au Québec, les associations françaises se présentent souvent comme des espaces où se construisent et se mettent en forme des utopies, où le travail se ferait en accord avec des valeurs sociales et non avec la recherche de profit. Or, ayant des expériences importantes dans les milieux associatifs (à titre d’intervenantes, de salariées et de membre de conseil d’administration), les autrices se sont rapidement butées au mirage associatif, dans un contexte de travail marqué notamment par un sous-financement chronique, un précariat en emploi et un taux de roulement du personnel qui rend difficiles les possibilités de s’organiser. Le constat d’écarts forts entre les discours produits par les associations et le travail réel, ainsi que la réception des critiques qui est parfois reçue très durement leur a donné l’envie d’écrire ce livre.
Pour tenter de mieux comprendre leur environnement, ses mécanismes d’exploitation, et pour réussir à collectiviser les causes des burn-out récurrents en milieu associatif, les autrices ont entrepris un travail d’enquête du travail à travers une série d’entrevues et d’analyses. Leurs analyses trouvent un certain écho avec ce qu’il se passe dans les milieux communautaires au Québec – une réalité que l’on apprend parfois à ses dépends.
Dans cette publication, nous proposons donc un extrait du livre Te plains pas, c’est pas l’usine : l’exploitation en milieu associatif dans lequel les autrices définissent ce qu’elles ont appelé le « sous-prolétariat associatif », cette catégorie de bénévoles, petits salariés et allocataires qui font rouler l’économie de l’association. – AB
Sous-traitants sous-payés
En janvier 2013, le ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, met en place la réforme dite « des rythmes scolaires ». Il s’agit d’ajouter une demi-journée d’école par semaine tout en diminuant le nombre d’heures de classe quotidiennes. Le temps libéré, réorganisé, doit permettre aux enfants de pratiquer des activités de loisirs.
Ces activités, pour les mettre en place, il y a des appels à projets, des marchés publics. Pour les obtenir, les associations s’affrontent en essayant de réduire les coûts pour être compétitives. Il s’agit de recruter très vite, en quelques mois, parce que la réforme doit être mise en œuvre pour la rentrée suivante. Et il faut trouver des gens qui acceptent des salaires dérisoires et une organisation du travail particulièrement usante : horaires découpés, deux ou trois périodes travaillées par jour, pour un total de 14 heures hebdomadaires en moyenne.
Pour recruter, les associations usent et abusent de la rhétorique de l’engagement. Mais il apparaît aussi un nouveau discours pour vendre ces postes : des affiches fleurissent qui vantent la possibilité d’augmenter ses revenus, de compléter un temps partiel. L’argumentaire s’adresse donc à des galériens et à des galériennes, et ne cherche plus vraiment à mettre en avant des considérations politiques ou éducatives. En effet, comment parler d’engagement quand il s’agit de détruire complètement le rythme de sa semaine, de galérer quatre fois par jour dans les transports en commun ? Un engagement pour 450 euros par mois, que viendront compléter des ménages, ou un boulot au noir ?
Si la précarité est une situation partagée par la majorité des travailleurs du monde associatif, c’est peut-être bien la seule « condition » commune. Il y a des statuts différents, des contradictions internes fortes, et l’on n’y occupe pas la même place en fonction de qui on est. Une très large partie du secteur est composée de structures qui proposent des emplois non seulement précaires, mais aussi non qualifiés, réservés à un personnel non diplômé, dont le travail est constamment dévalué et mal payé, quel que soit le domaine d’activité. En gros, les associations font bosser pour des miettes celles et ceux qui ne trouvent pas de travail ailleurs, qui sont peu « employables », à des postes peu gratifiants, mais souvent bel et bien nécessaires à maintenir un minimum d’ordre dans le monde. S’occuper des enfants en dehors du temps scolaire, les nourrir, aider à la toilette des personnes âgées isolées, ramasser les papiers gras sur les plages : pour ce genre de mission, l’État pousse de plus en plus souvent les associations à embaucher des pauvres sans qualification en les payant le moins possible. Ces sous-traitants déguisés de l’État constituent une sorte de sous-prolétariat associatif : temps de travail morcelé, contrats précaires, accès aux droits sociaux les plus élémentaires dénié.
Le Service civique est un dispositif particulièrement représentatif de la manière dont l’État, par l’intermédiaire du secteur associatif, organise un système qui fait travailler des gens pour presque rien. Il y a deux catégories de jeunes qui se retrouvent à effectuer des Services civiques : d’un côté, des étudiant·e·s, pour qui on peut raisonnablement penser que le Service civique est un tremplin, un moyen de « se faire du réseau », voire parfois un choix, le temps de trouver une orientation qui leur plaise vraiment ; et d’un autre côté celles et ceux qui voient dans le Service civique un « vrai » boulot, le seul qui leur est accessible à part livreur de sandwichs à vélo.
Ce dispositif permet de faire patienter les jeunes jusqu’au [revenu de solidarité active], de maintenir des dispositifs de contrôle, de gérer un peu mieux les jeunes destinés à des boulots de merde entrecoupés de chômage – cette main-d’œuvre en trop qui doit rester disponible en cas de besoin. Et les associations profitent bien de ce dispositif qui permet d’employer des gens pour effectuer les tâches les plus ingrates en ne déboursant quasiment rien – cela alors que le taux de prise en charge des emplois aidés par l’État est de plus en plus faible.
Présenté comme un volontariat permettant de valoriser un engagement pour le bien commun, c’est donc un emploi salarié déguisé, payé moins de 500 euros par mois et qui n’ouvre aucun droit social. Mais c’est aussi un dispositif idéologique fort. Il est du côté de la morale, du « bien », de l’engagement, de la « réparation de la fracture sociale ». Et il offre « une chance » à des jeunes qui autrement, dans l’imaginaire commun, auraient vendu du shit pour survivre.
B. a grandi dans une cité. Il n’a pas eu de très bonnes notes à l’école, sort d’un établissement avec une mauvaise réputation, et a galéré à faire ses vœux sur Parcoursup. Il travaille en moyenne de 26 à 30 heures par semaine contre l’indemnité de Service civique (472 euros), dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité. L’association est encadrée par des salarié·e·s rémunéré·e·s beaucoup moins que ce à quoi leur niveau d’études pourrait leur faire prétendre. Ils s’occupent de chercher les subventions, de rédiger les dossiers, d’encadrer les Services civiques. L’association envoie des étudiants aider des enfants de quartiers pauvres à faire leurs devoirs – ces étudiants sont bénévoles, mais ce boulot leur permet d’obtenir des crédits en vue de valider leur diplôme universitaire.
Les mains dans le cambouis, B., lui, se tape le sale boulot : organiser, faire les plannings, passer les coups de fil, etc. Les activités de cette association ont tout d’une « bonne œuvre » morale, mais si on se penche sur la façon dont cette « bonne œuvre » fonctionne vraiment, on voit bien qu’une des personnes indispensables à son exécution, c’est B., ultra-précaire, issu des quartiers, mal payé. Ce qu’il voit, lui, c’est qu’il se retrouve à faire des tâches ultra-répétitives et aucunement gratifiantes, et qu’il ne rencontre nulle reconnaissance au sein de l’association. Il raconte : « Les salariés ne foutent rien dans leurs bureaux, semblent noyés dans leurs problèmes, etc., mais ils n’arrêtent pas de répéter que ce qu’ils font est très bien. On a l’impression qu’ils sauvent le monde. Moi, je me fais juste chier et les gens me parlent mal. »
Le Service civique, ce n’est encore rien à côté de ce que les gouvernants ne cessent d’annoncer comme « le » dispositif d’avenir pour remettre le pied à l’étrier des pauvres qui touchent des allocations : le bénévolat.
Le bénévolat a bonne presse. Le terme est très lié à l’idée de charité, d’engagement désintéressé pour une cause, de « don », qui serait en dehors du travail. Historiquement, c’est un terme qui renvoie à son lot de clichés : des femmes désœuvrées et plutôt bourgeoises qui tricotent des pulls pour les mal-logés, des chrétiens charitables, des nettoyeurs acharnés de parcs pour que les enfants jouent dans un environnement plus sécurisé, des altermondialistes aux pantalons larges qui sont bénévoles pour le commerce équitable… Peut-être cela existe-t-il… Mais ce qui existe aussi beaucoup dans les associations, ce sont des bénévoles contraints par mesure de justice (les fameux tig, « travaux d’intérêt général »), ou d’autres qui se retrouvent là parce que le statut de « bénévole indemnisé » est la seule possibilité de travail qui leur soit ouverte. Ces personnes ont une sorte d’obligation à être bénévoles, parce qu’elles doivent prouver une volonté d’insertion, un dévouement au système. Elles sont cantonnées, même dans le bénévolat, à un travail inintéressant, qui ne peut leur servir qu’à se faire moins vite supprimer les aides sociales – puisqu’il faut de plus en plus, pour les conserver, justifier d’une activité. Les politiques d’austérité actuelles tendent à généraliser cette catégorie : elle est promue comme mesure d’insertion contrainte à droite comme à gauche.
Pour les associations, le bénévolat constitue souvent une manière de bénéficier d’une force de travail gratuite, dont elles usent abondamment, et qui permet en outre de mettre la pression aux salarié·e·s. Pour les pauvres que l’État pousse (ou contraint – alors ça s’apparente à de l’esclavage) dans cette direction, le bénévolat peut nourrir l’espoir abrutissant de, peut-être, un jour, pouvoir faire la même chose avec un statut précaire, ou peut tout simplement apparaitre comme une nécessité disciplinaire, au cas ou Pôle emploi ou le SPIP (le Service pénitentiaire d’insertion et de probation, chargé de fliquer les personnes sous main de justice) poserait des questions.
Extrait du livre Te plains pas, c’est pas l’usine : l’exploitation en milieu associatif, écrit par Stella Fihn et Lily Zalzett, paru en 2020 chez niet!Éditions .
Les illustrations sont tirées de Factory, l’œuvre de Atmosphere Studio.